Jean Arthaud de la Ferrière
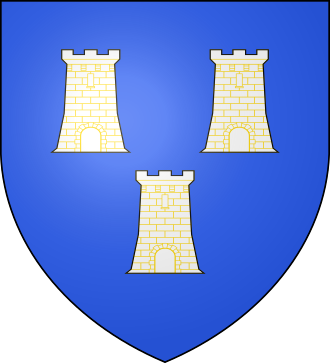
📖 Biographie
Né en 1613 aux Hières, Jean Arthaud incarne l’une des ascensions sociales les plus remarquables du XVIIᵉ siècle dauphinois. Issu d’une famille modeste de montagnards, il appartient à un monde que rien ne destinait aux hautes charges urbaines. Pourtant, comme beaucoup de jeunes hommes brillants du Haut-Dauphiné, il est très tôt orienté vers une éducation solide : les vallées alpines fournissaient depuis longtemps des clercs, des notaires et des administrateurs aux grandes villes du royaume.
C’est dans ce contexte qu’il quitte les Hières pour Lyon. Là, il gravit avec une rapidité étonnante les échelons de l’administration municipale. En 1656, il est nommé trésorier et recteur de l’Hôtel-Dieu de Lyon, institution immense qui gérait fortunes, propriétés, legs et rentes de toute la ville. Être recteur, c’était appartenir au cœur du pouvoir charitable, financier et administratif lyonnais.
Sa carrière atteint son sommet en 1662, lorsqu’il devient échevin de Lyon. Cet office, l’un des plus élevés, offrait non seulement prestige et influence, mais aussi la noblesse personnelle : Jean devient alors, juridiquement, “Noble Jean Arthaud”. Ce titre n’est pas un héritage familial, mais le résultat d’un office anoblissant, typique de la noblesse de robe lyonnaise. Ses frères, comme Guillaume, restèrent roturiers : seule la charge conférée à Jean lui accorde ce statut.
Cet anoblissement ouvre cependant la voie à l’ascension du reste de la famille. Son neveu André Arthaud (1648–1728), fils de Guillaume, suit la même voie : échevin de Lyon en 1677, il devient à son tour noble par office, acquiert la seigneurie de Bellevue, puis épouse Marie-Anne de Masso, issue d’une famille noble. Ce mariage entraînera une substitution de nom et d’armes, et leurs descendants deviendront comtes de La Ferrière, consacrant définitivement la réussite de cette lignée issue des pentes du Haut-Oisans.
Malgré les honneurs, Jean Arthaud resta profondément attaché à son pays natal. Il lègue à l’Hôtel-Dieu des sommes considérables, avec obligation d’entretenir deux enfants de La Grave jusqu’à leur majorité, en les plaçant dans une école supérieure ou un séminaire : une manière de permettre à d’autres montagnards de suivre la voie qu’il avait lui-même empruntée.
Il fonde également, par donation, une école dans sa commune natale, dont l’Hospice de Lyon devait assurer les revenus.
Enfin, selon le Répertoire archéologique du département des Hautes-Alpes (1880), Jean Arthaud légua sa propre maison aux Hières pour qu’elle soit transformée en chapelle. Cette maison devint la chapelle des Pénitents Saint-Barthélémy, où l’on dit que son portrait et son blason sont encore visibles. C’est un témoignage rare, presque intime, de la mémoire laissée par cet homme dans son village d’origine.
De tous les enfants nés dans les villages reculés du Haut-Oisans au XVIIᵉ siècle, peu connurent un destin comparable. Parti des Hières, formé dans les réseaux administratifs lyonnais, devenu noble par son mérite et ses charges, Jean Arthaud a hissé sa famille dans l’aristocratie. Son parcours, spectaculaire mais parfaitement ancré dans les mécanismes sociaux de l’époque, demeure l’un des exemples les plus lumineux d’ascension alpine sous l’Ancien Régime — et l’une des figures majeures de l’histoire de La Grave.
Dans son ouvrage de 1913, Hippolyte Muller décrit les habitants du canton comme une « population cultivée, obligeante et plus instruite que ne le sont habituellement les populations montagnardes ». Peut-on voir dans cette singularité l’héritage lointain de générations d’hommes et de femmes ayant œuvré à développer leur vallée — et, parmi eux, l’influence discrète mais réelle d’un homme comme Jean Arthaud ?
📌 Informations
🎂 Naissance
01/01/1613
🪦 Décès
23/08/1663
🧑 Auteur
admin
🔗 Source
Bibliothèque Nationale de France -- Muller Hippolyte, Quelques notes sur La Grave et son canton (1913)
🗺️ Lieux associés
- ➡️ Les Hières